Comment fonctionne le réinvestissement d’un apport-cession ?
Vendre son entreprise représente souvent le projet d’une vie. C’est le fruit d’années d’efforts, de risques assumés et de décisions stratégiques. Pourtant, le moment de la cession s’accompagne toujours d’un enjeu crucial : comment préserver la valeur créée tout en maîtrisant l’imposition sur la plus-value ?
Le mécanisme de l’apport-cession et du réinvestissement, prévu par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI), répond précisément à cette question. Il permet de différer l’imposition sur les plus-values réalisées lors de la vente des titres d’une société, à condition de réinvestir une partie du produit de cette vente dans de nouvelles activités économiques.
Ce dispositif s’adresse en particulier aux chefs d’entreprise, investisseurs et dirigeants-actionnaires souhaitant recycler leur capital dans de nouveaux projets tout en profitant d’un report d’imposition. Mais pour l’utiliser efficacement, encore faut-il bien en comprendre les mécanismes, les conditions d’éligibilité, les délais, et les pièges à éviter…

Apport, cession, réinvestissement : une mécanique à comprendre pas à pas
L’apport-cession est une opération en plusieurs étapes successives, qu’il faut maîtriser dans sa chronologie et ses implications fiscales.
Étape 1 : L’apport à une société holding
Le point de départ consiste à apporter les titres de votre entreprise à une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), dont vous détenez le contrôle. Cette opération crée une plus-value d’apport – la différence entre la valeur actuelle des titres et leur valeur d’acquisition.
Cependant, au lieu d’être immédiatement imposée, cette plus-value est placée en report d’imposition : l’impôt est calculé mais suspendu tant que certaines conditions sont respectées.
Cet apport n’entraîne pas de décaissement fiscal immédiat ; il constitue donc un levier de souplesse et de planification.
Étape 2 : La cession des titres par la holding
Une fois l’apport réalisé, c’est la holding – et non plus vous directement – qui cède les titres à l’acquéreur. Elle encaisse donc le produit de la vente, sans déclencher d’imposition immédiate sur la plus-value d’apport, puisqu’elle est toujours en report.
Étape 3 : Le réinvestissement du produit de cession
C’est ici que la logique économique entre en jeu. Si la cession intervient moins de trois ans après l’apport, la holding doit réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans des activités économiques éligibles, et ce dans un délai de 24 mois.
Ce réinvestissement peut se faire en direct, via l’acquisition d’une entreprise ou le financement de nouveaux actifs, ou indirectement via des fonds d’investissement (FCPR, FPCI, SLP, SCR).
Étape 4 : La conservation et le suivi
Une fois les réinvestissements réalisés, la holding doit conserver les actifs :
- pendant au moins 12 mois pour les investissements en direct ;
- et au moins 5 ans pour les placements réalisés via des fonds.
Le non-respect de ces délais entraîne la fin du report d’imposition et le déclenchement immédiat de l’impôt sur la plus-value d’apport.
Comprendre la logique du réinvestissement de l’apport-cession
Si la vente des titres apportés intervient plus de trois ans après l’apport, la liberté est totale : le produit de cession peut être utilisé sans contrainte particulière.
En revanche, si la cession a lieu moins de trois ans après l’apport, la loi impose un cadre strict pour maintenir le report d’imposition : au moins 60 % du produit de la vente doit être réinvesti dans des activités économiques éligibles dans un délai de 24 mois.
Ce réinvestissement peut se faire en direct (par exemple en acquérant le contrôle d’une société existante ou en finançant de nouveaux actifs d’exploitation) ou indirectement, via des fonds d’investissement spécialisés comme les FCPR, FPCI, SLP ou SCR.
L’idée sous-jacente est que l’État accepte de différer sa perception d’impôt si le capital issu de la vente est réinjecté dans l’économie réelle, pour créer de la valeur, de l’emploi et du développement. C’est une forme de “prêt fiscal à taux zéro” au service de l’entrepreneuriat.
Les conditions clés pour bénéficier du report d’imposition
Comme tout dispositif fiscal avantageux, l’apport-cession est soumis à des conditions précises.
Tout d’abord, la holding qui reçoit les titres doit être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) et contrôlée par l’apporteur, c’est-à-dire qu’il doit détenir plus d’un tiers des droits de vote ou du capital.
Ensuite, si la cession intervient dans les trois ans suivant l’apport, la holding doit respecter les obligations suivantes :
- Réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans des actifs éligibles dans les 24 mois ;
- Conserver ces actifs pendant une durée minimale (12 mois pour les investissements en direct, 5 ans pour les fonds d’investissement) ;
S’assurer que les sociétés cibles du réinvestissement exercent une activité économique réelle (commerciale, industrielle, artisanale, agricole, libérale ou financière), avec un siège situé dans l’Union européenne et soumises à l’IS.
Certaines activités sont explicitement exclues, notamment la gestion d’un patrimoine immobilier ou mobilier à titre personnel. En revanche, les opérations immobilières d’exploitation, comme la promotion ou le marchand de biens, peuvent être éligibles, à condition d’une véritable substance économique.

Le mécanisme du report : un impôt différé, pas supprimé
Il est essentiel de comprendre que le dispositif n’efface pas l’impôt, il le diffère.
Le report d’imposition signifie que la plus-value est calculée et enregistrée, mais que son paiement est repoussé dans le temps. Cette plus-value reste donc “en sommeil” dans les comptes de la holding jusqu’à ce qu’un événement de rupture intervienne : distribution de dividendes, liquidation, transfert de résidence fiscale, etc.
Le grand intérêt de ce mécanisme réside dans le fait qu’entre-temps, le produit de cession peut être réinvesti et faire fructifier le capital, créant potentiellement une rentabilité supérieure à l’économie d’impôt différée.
En d’autres termes, l’apport-cession est une opération financièrement neutre à court terme, mais extrêmement puissante à moyen terme si elle s’inscrit dans une stratégie d’investissement cohérente.
Réinvestir : en direct ou via des fonds, deux approches complémentaires
La loi offre deux grandes options pour réemployer le produit de cession : le réinvestissement direct dans des sociétés ou le réinvestissement indirect via des véhicules collectifs d’investissement.
1. Le réinvestissement direct : reprendre le contrôle d’un projet
Le réinvestissement direct consiste à injecter le capital dans des sociétés exerçant une activité éligible. Il peut s’agir :
- de prendre le contrôle d’une nouvelle entreprise ;
- de financer des actifs nécessaires à l’exploitation d’une société déjà existante ;
- ou de participer à la création d’une société via une souscription au capital.
Ce type de réinvestissement est souvent privilégié par les entrepreneurs qui souhaitent rester acteurs du développement économique. Il permet une maîtrise totale du projet et la création de valeur ajoutée à long terme.
En revanche, il nécessite du temps, des compétences et une forte implication dans la gestion opérationnelle. Par ailleurs, la concentration du risque sur un nombre limité de projets peut fragiliser l’équilibre global du patrimoine.
2. Le réinvestissement via des fonds : mutualiser le risque et déléguer la gestion
Pour les dirigeants qui souhaitent déléguer la gestion tout en bénéficiant du régime fiscal, il est possible d’investir via des fonds d’investissement éligibles : FCPR, FPCI, SLP ou SCR.
Ces fonds investissent eux-mêmes dans des entreprises non cotées (private equity), couvrant des secteurs variés : capital-risque, capital-développement, capital-transmission ou retournement.
Les avantages de cette approche sont multiples :
- la diversification immédiate du portefeuille ;
- la gestion déléguée à des experts ;
- un calendrier compatible avec les obligations légales (appels de fonds sur 5 ans, conservation minimale de 5 ans) ;
- et souvent une fiscalité allégée sur les plus-values à terme.
La contrepartie réside dans la faible liquidité et les frais de gestion inhérents aux fonds de private equity. C’est donc une approche à envisager dans une logique de long terme.
Les délais : une question de rigueur et d’anticipation
Le respect des délais est un élément central du dispositif.
Le calendrier se déroule ainsi :
- Apport des titres à la holding : début du report d’imposition ;
- Cession des titres par la holding : déclenchement du délai de 24 mois pour réinvestir (si la vente intervient avant 3 ans) ;
- Réinvestissement effectif : le quota de 60 % doit être atteint dans les 2 ans, les investissements devant ensuite être conservés (12 mois minimum en direct, 5 ans pour les fonds).
En pratique, ces délais exigent une planification minutieuse. Il est souvent conseillé de préparer le pipeline de réinvestissement dès la cession, afin d’éviter une course contre la montre à l’approche de l’échéance.
Toute opération réalisée au dernier moment ou mal documentée expose à la remise en cause du report d’imposition, ce qui annule tous les bénéfices du dispositif.
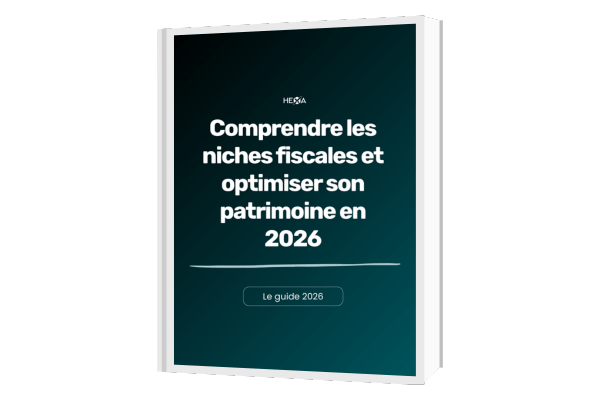
Apport-cession : évitez l’erreur fiscale — téléchargez le livre blanc 150-0 B ter
Pour aller plus loin et sécuriser votre stratégie d’apport-cession, nous avons réuni dans un livre blanc clair et opérationnel tout ce qu’il faut savoir sur l’article 150-0 B ter : conditions de contrôle de la holding, délais à respecter, obligation de remploi (notamment le seuil de 60 % lorsque la cession intervient avant 3 ans), liste des investissements éligibles et erreurs qui peuvent entraîner la remise en cause du report d’imposition. Le dispositif est un levier puissant, mais technique et très encadré : une bonne lecture des règles et des points de vigilance fait souvent la différence entre une optimisation réussie et un risque fiscal inutile. Téléchargez gratuitement le livre blanc pour disposer d’un guide complet, illustré d’exemples, et avancer sereinement dans la construction de votre réinvestissement.
Les obligations déclaratives et le suivi de conformité
Au-delà de la stratégie financière, le succès d’un apport-cession repose sur une rigueur documentaire irréprochable.
La holding doit conserver et produire un ensemble de justificatifs attestant du respect des conditions légales :
- procès-verbaux d’assemblée autorisant les investissements,
- attestations de réinvestissement émises par les fonds ou les sociétés cibles,
- preuves de paiement,
- documentation sur la structure de contrôle et l’activité économique réelle.
De plus, les déclarations fiscales annuelles doivent mentionner la présence d’un report d’imposition et l’état d’avancement des réinvestissements.
Cette gouvernance documentaire n’est pas qu’une formalité : elle constitue la preuve de bonne foi du contribuable et la meilleure protection contre un redressement fiscal.
Les risques de l’apport-cession réinvestissement : fiscalité, liquidité et conformité
Le dispositif, bien que puissant, n’est pas sans risques.
Sur le plan fiscal, l’administration surveille étroitement les opérations d’apport-cession. Toute structure artificielle, sans véritable substance économique, peut être requalifiée en abus de droit. Dans ce cas, la plus-value devient immédiatement imposable, avec des pénalités.
Sur le plan financier, le réinvestissement expose à des risques de liquidité (fonds bloqués pendant plusieurs années) et de performance (rendement incertain des actifs économiques ou des fonds).
Enfin, le non-respect des délais ou des conditions de conservation peut entraîner la perte totale du report d’imposition.
La clé, ici, réside dans la préparation et l’accompagnement. Il est vivement conseillé de travailler main dans la main avec un conseiller fiscal et un expert en gestion de patrimoine, afin d’anticiper les scénarios et d’éviter toute erreur irréversible.
Conclusion : de la fiscalité à la stratégie patrimoniale
Le réinvestissement d’un apport-cession ne se résume pas à une astuce fiscale : c’est un véritable levier de gestion de patrimoine et de réinvestissement économique. En respectant les conditions de l’article 150-0 B ter du CGI, il devient possible de vendre son entreprise, de reporter l’imposition sur la plus-value, et surtout, de redéployer son capital dans des projets porteurs de sens et de rendement.
Cette approche demande cependant de la rigueur, de la planification et une expertise technique solide. Le moindre oubli documentaire, un délai dépassé ou un choix d’investissement inéligible peuvent remettre en cause le bénéfice du report. C’est pourquoi l’apport-cession doit s’envisager non comme un simple dispositif fiscal, mais comme un pilier structurant d’une stratégie patrimoniale globale.
Chez Hexa Patrimoine, nous aidons les chefs d’entreprise, investisseurs et familles à transformer leur cession en une opportunité patrimoniale durable.
Notre approche repose sur trois piliers :
- Conseil stratégique et fiscal : diagnostic préalable, choix du schéma juridique, coordination avec vos conseils fiscaux et comptables.
- Sécurisation du dispositif 150-0 B ter : respect des conditions, accompagnement documentaire, suivi des obligations déclaratives.
- Sélection et suivi des réinvestissements éligibles : fonds de capital-investissement, opérations de croissance, actifs réels productifs.
Vous songez à céder votre entreprise ? Discutez en avec un conseiller
Le présent article a une vocation exclusivement informative et pédagogique.
Il ne constitue ni un conseil fiscal, ni un conseil financier personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons vivement de consulter un conseiller fiscal, avocat ou expert-comptable avant toute décision d’apport, de cession ou de réinvestissement.
À propos d’Hexa Patrimoine
Hexa Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans la stratégie patrimoniale, la fiscalité du chef d’entreprise et l’investissement à impact durable.
Nous accompagnons nos clients à chaque étape de la vie de leur entreprise — de la création à la transmission — avec une approche sur mesure, fondée sur la transparence, la pédagogie et la performance long terme.
📞 Vous envisagez une opération d’apport-cession ou un réinvestissement ?
Parlez-en avec un de nos experts pour définir la stratégie la plus adaptée à vos objectifs

À propos de l’auteur
Sébastien MARTINEZ – Fondateur Associé d’HEXA PATRIMOINE
Professionnel de la gestion de patrimoine depuis 2003, Sébastien MARTINEZ fonde en 2008 le cabinet EXCELLIS, devenu aujourd’hui HEXA PATRIMOINE, un acteur indépendant reconnu en Rhône-Alpes Auvergne. Titulaire du Diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand et de l’ensemble des cartes professionnelles du secteur, il place l’intérêt de ses clients au cœur de sa démarche. En 2022, avec son associée Laurence MARTINEZ, il initie le développement d’un réseau d’agences à l’échelle nationale. Sébastien MARTINEZ signe ici un article nourri de son expérience terrain et de sa vision durable de la gestion patrimoniale.